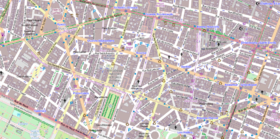Passage du Grand-Cerf
 2e arrt Passage du Grand-Cerf
| |||
|
| |||
| Situation | |||
|---|---|---|---|
| Arrondissement | 2e | ||
| Quartier | Bonne-Nouvelle | ||
| Début | 145, rue Saint-Denis | ||
| Fin | 8, rue Dussoubs | ||
| Morphologie | |||
| Longueur | 117 m | ||
| Largeur | 3 m | ||
| Historique | |||
| Création | 1825 | ||
| Géocodification | |||
| Ville de Paris | 4230 | ||
| DGI | 4269 | ||
| Géolocalisation sur la carte : Paris
Géolocalisation sur la carte : 2e arrondissement de Paris
| |||
| modifier |
|||
Le passage du Grand-Cerf est un passage couvert situé dans le 2e arrondissement de Paris, en France.
Situation et accès
Il est prolongé vers l'est par le passage du Bourg-l'Abbé, et vers l'ouest par la rue Marie-Stuart.
Le passage du Grand-Cerf abrite des boutiques d'artisans, créateurs, décorateurs, mode, designers et des métiers de la communication.
Ce site est desservi par la station de métro Étienne Marcel.
Dénomination
Le nom du passage fait référence à une ancienne enseigne.
Historique
Le passage est ouvert en 1825 sur l'emplacement de l'hôtel du Grand Cerf. Cet hôtel, qui appartenait à l'administration des Hospices, avait été vendu le 10 avril 1812 à M. Hermain. Il est acheté le 24 mai 1825 par la compagnie bancaire Devaux-Moisson et Cie qui transforma le passage avant de le revendre le 7 juin 1826 à Isidore Monier qui en possédait déjà une partie.
Les textes ne précisent pas la nature des travaux faits en 1825 mais on sait que le passage est ouvert à cette date. On sait aussi que le passage du Bourg-l'Abbé qui lui fait face, rue Saint-Denis, est inauguré en avril 1828 et un guide daté de 1831 signale que le passage du Grand-Cerf est « encore en construction ». Un texte de 1835 le signale dans la liste des passages. Mais dans le livre de Marlès, Paris ancien et moderne, de 1837, il indique qu'« il n'a rien de remarquable ; on le trouvait très beau il y a trente ans, avant la construction des nouveaux passages ».
En 1830, au numéro 6, se trouve le siège du journal L'Extra-Muros où écrit assidûment le poète, chansonnier et goguettier Émile Debraux[1].
L'architecture actuelle du passage le fait plutôt remonter aux années 1845 que 1825.
Il a été légué en 1862 à l'Assistance publique par l'héritier de la famille Monier. À l'époque, son revenu était de 87 217 francs pour une valeur estimée de 850 000 francs. Mais les revenus du passage ne cessant de décroître, il fut mis en location et adjugé à un certain Dejuuean[Quoi ?] pour la somme de 94 500 francs après 1882. Celui-ci se retira en 1890. En 1896, le passage ne rapporte plus que 52 627 francs. Un rapport note que cette désaffection était due « à ce trop grand abandon dans lequel on avait laissé l'immeuble ».
Il faut investir pour l'entretenir et finalement l'Assistance publique envisage de le vendre. Après des échecs, il a été finalement vendu en 1985. Cela a permis de le restaurer et de le reconstruire à l'identique.
Une séquence du film de Louis Malle Zazie dans le métro a été tournée en 1960 dans le passage[2].
Depuis 2016, une vingtaine de commerçants du passage accepte les paiements en bitcoin[3].
-
Entrée place Goldoni.
-
Entrée rue Saint-Denis.
Bâtiments remarquables et lieux de mémoire
- Anne Français (1909-1995), artiste peintre, vécut au 4, passage du Grand-Cerf.
Voir aussi
Bibliographie
- Bertrand Lemoine, Les Passages couverts en France, Paris, Délégation à l'Action artistique de la ville de Paris, 1997, 253 p. (ISBN 2-905-118-21-0), p. 114-116.
- Bernard Marrey, Paul Chemetov, Familièrement inconnues… architectures. Paris, 1848-1914, Paris, secrétariat d'État à la culture, 1976, p. 15.
Notes et références
- Paul Jarry, « Les chansons de nos grand'mères », Bulletin de la Société archéologique, historique et artistique Le Vieux Papier, tome XII, p. 4 et 5, 1913.
- Marie-Françoise Leudet, Lionel Labosse et Agnès Vinas, « Queneau – Malle », Zazie dans le métro (1959-1960), les lieux », www.lettresvolees.fr.
- Les Echos, 2018-0120.
Articles connexes
Liens externes
- Passage du Grand-Cerf (Mairie de Paris)
- Passage du Grand Cerf (Office du tourisme)